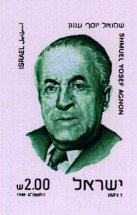
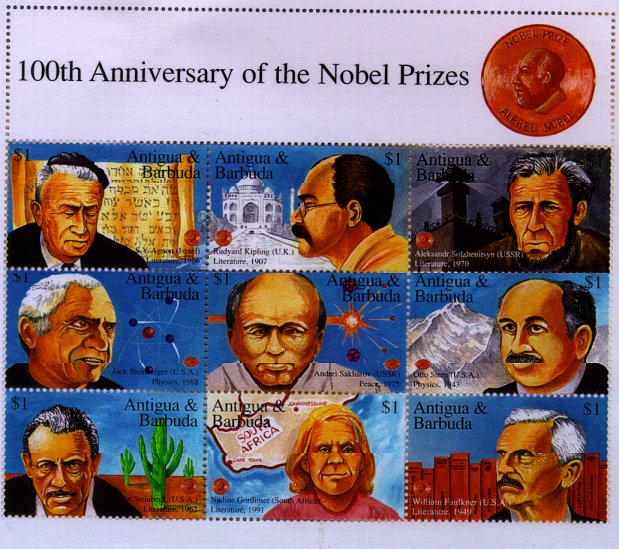
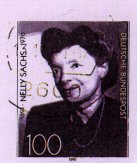


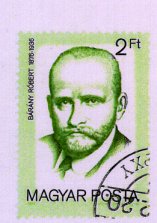
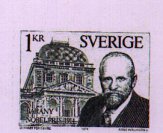
DE LA
JUDAICA ET
DE QUELQUES PRIX
NOBEL
MECONNUS
OU OUBLIES
José SALMONA
J’ai, depuis longtemps déjà,
éprouvé une curiosité très particulière pour la vie et l’œuvre des
grands savants et j’ai pensé concrétiser cet intérêt, en plus des
biographies et autres écrits, par une représentation figurative de ces
personnages célèbres. J’ai donc décidé d’adjoindre à une collection de
timbre, quelque peu disparate, une thématique plus précise, et en particulier
celle des « Prix Nobel ».
Instituée par le chimiste suédois
Alfred Nobel cinq ans après la signature à Paris de son célèbre testament en
novembre 1895, la Fondation NOBEL recevra ses premiers statuts de la main du roi
Oscar II de Suède. Les premiers Prix seront accordés en 1901, soit cinq ans
aussi après la mort d’Alfred Nobel, en décembre 1896, dans sa maison de San
Rémo en Italie.
Le domaine du « NOBEL »
se limitait à 5 disciplines : la physique, la chimie, la médecine
& physiologie, la littérature et la promotion de la
paix. Plus récemment, en 1968, un prix de Sciences Economiques a été
institué par la Banque de Suède à la mémoire d’Alfred Nobel.
La quête de ces personnages
illustres a été le point de départ de ma nouvelle collection. Par la suite,
tout en maintenant mon intérêt pour les NOBEL, je me suis lancé dans la
« JUDAICA ».
Si le NOBEL se limitait à un
domaine relativement restreint (les 6
disciplines citées plus haut), la JUDAICA m’offrait un champ plus divers
et plus vaste puisqu’il me permettait d’inclure des sujets aussi intéressants,
tels les Beaux Arts, l’architecture, la musique, les mathématiques, etc.
Comme la rumeur (et aussi les statistiques) le laisse entendre, 10 pour cent des
Prix Nobel seraient juifs ou d’origine juive. Ceci constituait déjà un petit
« capital de départ » pour ma Judaïca.
Pour en revenir à mon sujet
propre, j’ai choisi de vous présenter des personnages tout aussi méritants
que les Bergson, Cassin, Einstein, Bohr, mais qui ont sombré dans l’oubli ou
l’anonymat, le temps faisant aussi son œuvre pour les plus anciens.
Robert
BARANY (1876-1936)
Robert
Bârâny, né à Vienne
en 1876, y a fait ses études de médecine
et obtenu son doctorat en 1900. Spécialisé en otologie, il est nommé maître
de conférence à la Clinique Ontologique de Vienne. Ses recherches sur la
fonction du labyrinthe (oreille interne) où
est situé l’organe responsable de l’équilibre (canaux semi-circulaires) ainsi que des procédures opératoires
originales dans l’otosclérose lui ont valu le Prix Nobel en 1914.
En dépit de cette récompense
prestigieuse, il ne put obtenir une chaire à l’Université de Vienne en
raison de sa judéité.
Au cours de la Première
Guerre Mondiale, il servit dans l’armée austro-hongroise.
Ses recherches approfondies
dans le domaine de l’otologie ont constitué la base de notre connaissance
actuelle sur la fonction du labyrinthe.
En 1917, il est nommé
professeur d’otologie à l’Université d’Uppsala en Suède, dont la Faculté
de Médecine est une des plus anciennes et des plus réputées d’Europe.
Dans les dernières années de
sa vie, il s’intéresse beaucoup au problème de la Palestine et il lègue sa
bibliothèque à la Librairie Nationale de Jérusalem.
Karl
LANDSTEINER (1868-1943)
Karl Landsteiner, né à
Vienne en 1868, étudie la médecine dans cette ville.
Au cours de ses travaux à
l’Institut de Pathologie à l’Université, il fait une découverte majeure
sur les différents groupes sanguins A,
B, AB et O et met au point
les méthodes pour leur recherche et leur identification.
En 1922, il est invité à
travailler à « l’Institut Rockfeller pour la Recherche Médicale »
à New York où il œuvre jusqu’à sa mort, en 1943.
A la tête d’un groupe de
recherche, il découvre, en 1927, des facteurs sanguins complémentaires
M, N et MN(***)
et, en 1940, il est au cœur de la découverte du Facteur RHESUS, facteur
responsable de certains accidents lors des transfusions sanguines et des
grossesses pathologiques.
Le Prix Nobel de Médecine & Physiologie lui est attribué en 1930, plus particulièrement pour ses travaux sur les groupes
sanguins.
(***)
(M et N sont des antigènes présents dans les globules rouges, formant les
types M, N et MN)
Lev Davidovitch LANDAU (1908-1968)
Physicien russe né à Bakou
en 1908.
Enfant prodige en mathématiques,
LANDAU termine ses études de mathématiques et de physique aux Universités de
Bakou et Leningrad à l’âge de 19 ans.
En 1934, il décroche son
titre de « Docteur es-sciences physiques et mathématiques » de l’Université
de Leningrad.
Dans l’intervalle, il
travaille quelques années (vers 1929-1930) à Copenhague auprès de Niels BOHR,
directeur de l’Institut de Physique Théorique (Prix
Nobel de Physique en 1922) considéré déjà comme une sommité mondiale
dans le domaine de la structure atomique.
En 1931, LANDAU rentre en URSS
et il rejoint l’Institut Physico-Technique de Leningrad. En 1937, il prend la
tête de l’Institut des Problèmes Physiques de Moscou. Il y développe ses théories
sur les propriétés de l’Hélium II et de l’Hélium III en termes de mécanique
quantique ainsi que sur la physique des « basses températures ».
L’excellence de ses travaux lui valent, en novembre 1962, le Prix Nobel de Physique.
Il est également titulaire à deux reprises du Prix Lénine.
En dépit de sa notoriété et
bien avant son Prix Nobel, il passe quelques mois dans les geôles russes
(1938-1939) à la suite des premières purges staliniennes. Il est libéré sur
l’intervention de Kapitsa, autre grand savant atomiste, auprès de Molotov.
Le 7 janvier 1962, sur une
route verglacée, un camion heurte de plein fouet une « Volga ». Des
débris de la voiture, on sort un homme, le front ouvert, la poitrine enfoncée,
le bassin écrasé. Cet homme n’est autre que Lev Landau.
Les médecins vont tout faire
pour sauver le blessé. Des spécialistes du monde entier, des chirurgiens,
offrent leur assistance. A quatre reprises le cœur de Landau s’arrête –
cliniquement, Landau est mort –, quatre fois on le ranime.
Lentement, le blessé se rétablit,
il récupère ses facultés intellectuelles. Son merveilleux cerveau n’est pas
atteint et en novembre, dix mois après son accident, il se voit décerner le
« NOBEL ».
Délaissant le domaine austère
de la Science, je vais aborder un sujet plus plaisant, celui de la littérature,
avec un Prix Nobel partagé entre Samuel Joseph AGNON et
Nelly SACHS.
Samuel
Joseph AGNON (1888-1970)
De son vrai nom CZACZKES, cet
écrivain, né en Galicie en 1888, sera le premier Prix Nobel israélien (1966).
De son père, il reçoit sa
première éducation juive classique, de sa mère un penchant pour la littérature
allemande. A l’âge de 8 ans il écrit ses premiers vers et, à 16 ans, il
publie de manière régulière de la poésie et de la prose en yiddish et en hébreu.
En 1907, il se rend en
Palestine et y demeure jusqu’en 1913. Un an plus tard, il publie son premier
roman « Agounot » sous le
nom de AGNON, qu’il adoptera officiellement en 1924. Pendant son séjour, il
participe activement à la fondation de la première ville juive, TEL AVIV.
De 1913 à 1924, AGNON réside
en Allemagne, où son œuvre trouve auprès de la jeunesse sioniste un accueil
enthousiaste. Il renoue des contacts avec BIALIK et rencontre Martin BUBER.
Il entame une carrière littéraire,
écrit plusieurs contes, qui seront publiés à Berlin et à Varsovie.
En 1924, retour à Jérusalem,
où il se fixe définitivement.
Son œuvre reflète la vie et
la mort du « shtetl » en Europe Orientale. Dans son roman « Le Trousseau de la Mariée », il décrit avec minutie
le monde complet et fermé dans lequel baigne le hassidisme galicien. Ce sujet
est aussi évoqué dans une autre de ses œuvres « l’Hôte
de Passage » (Albin Michel 1974).
AGNON s’intéresse aussi à
la vie des premiers pionniers en Palestine, dont la foi pour le travail manuel
se substitue à la foi religieuse. Une illustration en est donnée dans son
roman « Etmol-Shilshom » (Hier
et Avant-hier, 1931).
AGNON a développé un style
qui lui est propre, un mélange d’hébreu moderne et de langage talmudique.
Le Prix Nobel de littérature lui est décerné en 1966 pour l’ensemble de son œuvre.
Quelques-unes unes de ses œuvres
ont été traduites en français, notamment : « Contes
de Jérusalem », « Vingt
et une Nouvelles » et « Le
Chien Balak ».
Nelly
SACHS
(1891-1970)
Née à Berlin en 1891 dans
une famille de riches industriels israélites originaires de Dortmund, Nelly
Sachs commence à écrire dès l’âge de 16 ans. Bien que sa poésie soit tout
empreinte de la tradition romantique allemande, Nelly Sachs reste pratiquement
inconnue des Allemands. Ses ouvrages, quoique publiés depuis 1947, ne touchent
qu’un public limité.
Il aura fallu attendre un peu
plus de vingt ans, c’est à dire après que le « NOBEL »
(
littérature) lui fut décerné
en 1966, pour que son nom
apparaisse, en Allemagne d’abord, à la face du monde ensuite.
Dès ses débuts, Nelly Sachs
avait entretenu une correspondance avec
Selma Lagerlof, la romancière
suédoise. C’est d’ailleurs avec l’aide de celle-ci qu’elle put s’établir
en Suède, avec sa mère, en 1940, pour échapper aux persécutions nazies. Le
reste de sa famille périt dans les camps de concentration.
Avec l’avènement du
nazisme, les lois raciales, l’exil, l’œuvre de la poétesse est tout entière
vouée à la mémoire. L’expérience de la haine et de la souffrance la fait
se rapprocher du judaïsme. Elle écrit alors, en 1947, un ensemble de poèmes
intitulé
« Dans
les demeures de la mort » où elle retrace la
souffrance dans les camps de la mort et la tragédie du judaïsme européen sous
le régime de Hitler ainsi que « l’Obscurcissement
de l’Etoile » (Sternverdunklung),
évocateur de la fumée noire des fours crématoires.
Par la suite, elle publie une
série de trois recueils « Und
Niemand Weise Weiter »
(sur
le thème de Cain et Abel), en 1959 « Flucht
und Verwandlung » (Fuite et Métamorphose)
et, en 1966, « Die Suchende »
où elle reprend les mêmes thèmes mais les relie à l’Exil, auquel elle confère
une puissance de régénération, de retour aux sources, de renaissance.
En la récompensant en 1966,
le jury du Prix Nobel reconnaît en Nelly Sachs la plus grande poétesse
allemande contemporaine mais, celle-ci étant devenue suédoise, l’Académie
de Stockholm distingue un écrivain de « langue allemande » plutôt
qu’un écrivain de « nationalité allemande ». Elle avait fait de
même en 1946 lorsqu’elle attribua son Prix à Herman Hesse, qui avait acquis
la nationalité helvétique.
Ainsi donc, en l’espace d’une génération, ces deux Prix Nobel portent bien la marque du destin tragique de l’Allemagne au cours de cette moitié de siècle, comme si les meilleurs de ses enfants ne pouvaient être, à l’instar de ses nombreux savants et intellectuels poursuivis par la haine nazie, que les bannis, les persécutés et les exilés.
|
|
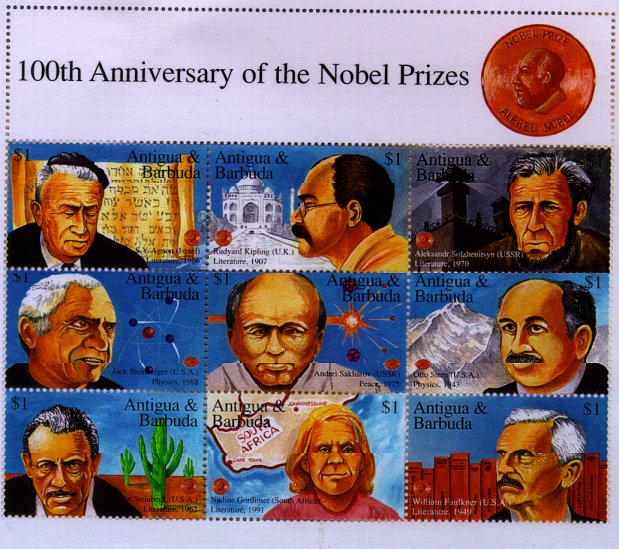 |
|
|
|
|